Histoire du domaine du Ratelet après la révolution.
Quel est donc ce domaine du Ratelet qu’Adélaïde Miger épouse Lacour achète en 1822, et dont l’élégante bâtisse nous interpelle encore aujourd’hui ?
L’histoire ancienne de ce domaine, érigé au début du XVIIème siècle sur l’emplacement d’un ancien prieuré est bien décrite dans le bulletin Epona n° 39 (https://epona-gatinais.fr/bulletins). Vers 1765 Claude Nicolas de Blegny, 40 ans, avocat au parlement de Paris, achète le château du Ratelet à Gabriel Jacques Mesnil. Il y meurt sans enfant le 25 octobre 1787. Sa sœur aînée Marie Louise de Blegny en hérite. Veuve d’un greffier des audiences civiles au Chatelet de Paris, Jean François Le Roux, elle a quatre enfants. Son fils aîné François Louis Le Roux (né vers 1750, lui aussi greffier des audiences civiles au Chatelet de Paris) assiste à l’inhumation de son oncle. Il est l’héritier du domaine du Ratelet, considéré comme impartageable, à condition d’en préserver l’usufruit à sa mère. Les autres enfants recevront chacun un quart de la succession de Marie Louise de Blegny à son décès le 4 décembre 1790. Propriétaire rue Michel Lecomte, paroisse Saint Nicolas des Champs à Paris, elle n’a probablement jamais séjourné au Ratelet autrement qu’en résidence d’été.
Rendons-nous aux Archives Départementales du Loiret à Orléans, section des hypothèques. Malheureusement, les actes antérieurs à 1830, si on retrouve leur trace et en particulier leur date, ont brulé dans l’incendie provoqué par un bombardement pendant la deuxième guerre mondiale. Nous n’aurons donc pas de description du Ratelet lors de son acquisition par les Lacour.
Le 28 novembre 1810, François Louis Leroux acquiert la ferme des Légers et ses dépendances. Cette ferme sera intégrée au domaine du Ratelet.
Le 17 février 1822, François Louis Le Roux vend le domaine du Ratelet à Louis Marin Thiercelin et sa femme Marie Charlotte Augustine Pichery, moyennant une rente viagère à verser à une veuve Decaille demeurant à Saint Hilaire les Andrésis.
Charles Lacour épouse Geneviève Adélaïde Miger en 1822. C’est elle qui achète, avec sa dot, le Ratelet le 18 décembre 1823 à Louis Marin Thiercelin. La famille Lacour, désormais Lacour du Ratelet, restera propriétaire résidante du Ratelet jusqu’en 1873.
Charles Louis Lacour du Ratelet décède en 1871 au château. Lorsque sa veuve meurt le 4 octobre 1873 au même endroit, elle n’a aucun descendant direct, son fils unique étant décédé en 1863. Son légataire universel est un petit cousin de 11 ans René Louis Gustave de Place, fils du général de brigade Gustave Henri de Place et d’une cousine de Geneviève Miger, Adélaïde Joséphine Jenny Miger.
Une fois les formalités de succession accomplies, le général de Place vend au nom de son fils le domaine du Ratelet au comte Pierre Charles Jacques Edouard Guéau de Reverseaux de Rouvray en octobre 1876, acte transcrit aux hypothèques d’Orléans le 30 novembre 1876. Le comte Edouard Guéau de Reverseaux est issu d’une famille ancienne de conseillers et avocats du Roi originaire de Chartres que l’on peut remonter jusqu’à son ancêtre Jacques Guéau, Ecuyer, Seigneur de Sainville et de Fontenay, lieutenant criminel au bailliage et Conseiller du Roi au présidial de Chartres, Chevaux léger de la garde du Roi, marié en 1634. Le grand oncle d’Edouard, Jacques Philippe Guéau de Reverseaux fut guillotiné le 24 pluviôse de l’an II.
En 1876, le domaine du Ratelet comporte : le château du Ratelet (environ 20 hectares), la ferme des Légers (environ 67 hectares), le moulin de la Planche (environ 11 hectares) et le moulin du Liard (environ 14 hectares).
L’acte donne du château du Ratelet une description précise : un corps de bâtiment principal élevé sur cave comptant un rez-de-chaussée, un étage et un grenier, flanqué de deux pavillons attenants à droite et à gauche, élevés sur cave d’un rez-de-chaussée et d’un étage. Diverses constructions complètent le bâti : écuries, remises, tour de colombier, hangar, puits muni d’une pompe. Ce château est entouré de murs avec grille et porte cochère pour entrer. Il donne sur une avenue conduisant à la route de Courtenay. Il comporte également une cour, une pièce d’eau et un canal d’irrigation. Le château lui-même couvre à peu près 1 ha. Les allées qui y mènent sont plantées d’arbres. S’y rapportent un jardin d’agrément (19 a), un potager (34 a), un jardin anglais (environ 3 ha), des vignes (50 a) et un verger (70 a). S’y rattachent encore environ 1 ha de terres cultivées, 43 a de prés et pâtures, 32 a de bois de haute futaie et 1 ha de friches et broussailles.
A partir de cette vente en 1876 et jusqu’après la deuxième guerre mondiale, le château du Ratelet ne sera plus occupé par ses propriétaires qu’en résidence d’été. Les différents recensements n’y retrouvent que des familles de jardiniers jusqu’en 1896, puis personne n’est enregistré au domaine jusqu’à la deuxième guerre mondiale.
Le comte Edouard Guéau de Reverseaux de Rouvray qui acquiert le château en 1876 à l’âge de 42 ans est auditeur au Conseil d’Etat à Paris où il habite. Marié en 1860, il a trois enfants : Clémence née en 1861, Jeanne née en 1862 et Léopold né en 1869. Après sa mort en novembre 1917, ses trois enfants revendent le domaine le 11 novembre 1918 à Mr Henri Carpentier industriel demeurant à Paris 39 boulevard Raspail. En ces périodes troublées (fin de la première guerre mondiale), l’acte précise que les vendeurs disposeront provisoirement de deux pièces du château pour y entreposer des biens mobiliers jusqu’à ce qu’ils puissent les récupérer sans encombre. Henri Carpentier âgé de 70 ans, est marié et père de deux enfants : Lionel 23 ans et Albert 20 ans. Henri Carpentier revendra le domaine le 19 juillet 1924.
L’acte de 1924 apporte à nouveau une description précise du domaine et permet d’apprécier les éléments de confort et la modernisation du château.
Le bâtiment principal comporte au rez-de-chaussée un vestibule avec grand escalier menant à l’étage d’où se distribuent une salle à manger avec cuisine et office attenants, une salle de billard et une bibliothèque. Cet étage dispose également de WC. Cinq chambres au premier étage, quatre cabinets de toilette, un WC ; un escalier vers le deuxième étage et un escalier de service. Au deuxième étage, deux chambres dont une est qualifiée de petite, un cabinet de toilette, un grenier et deux chambres de domestiques. Ce bâtiment est construit sur des caves dont la première contient un calorifère à air chaud. Le château disposait donc d’un chauffage central.
A l’ouest du bâtiment principal, une aile où on trouve au rez-de-chaussée une lingerie avec un grand fourneau, une salle de bains, un débarras, un escalier menant au premier étage composé de deux chambres avec un cabinet de toilette et un WC. Le deuxième étage, outre un grenier, accueille deux chambres de domestiques.
L’aile Est accueille sur tout son rez-de-chaussée une orangerie et une serre, au premier étage deux chambres dont une avec bibliothèque et un cabinet de toilette, au deuxième étage un grenier et deux chambres. A l’est de cette aile, deux cabinets d’aisance.
Les dépendances se détaillent en un grand hangar avec clapiers, deux écuries, un garage, le logement du jardinier (2 pièces) et six chambres de domestiques à l’étage ; un colombier, un réservoir à eau et un fruitier dans lequel se trouve une pompe électrique ; un manège élévatoire pour l’eau.
Enfin à l’emplacement de l’ancien moulin de la Planche, à l’extrémité du village, un corps de bâtiment abrite la turbine, la dynamo et le compteur électrique ainsi que la chambre des accumulateurs.
Le nouvel acquéreur est Mr Dominique Jules Albert Brandière, négociant originaire de Toulouse, domicilié boulevard Saint Michel à Paris. Il est marié et a trois enfants. La famille Brandière est restée propriétaire du Ratelet jusqu’à nos jours, puisque la femme de son plus jeune fils, madame Gertrude Brandière née Uhl, est décédée au Ratelet en 2019, à l’âge de 97 ans. Ce fils, Michel Brandière, a participé activement à la résistance pendant la deuxième guerre mondiale, au sein du groupe Jean Bart de Courtenay au rang de capitaine commandant la sixième compagnie, quatrième demi brigade des FFI.

Cet article a été publié en partie dans la bulletin Epona n°51.
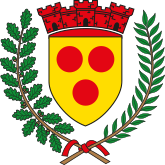

Laisser un commentaire