Le Loiret, terre d’orgues
Le Loiret est le département de la région Centre Val de Loire qui abrite le plus d’orgues, avec actuellement plus de 80 orgues en activité. Les premiers orgues dont on ait retrouvé la trace datent du Xème siècle avec celui de l’abbaye de Fleury (Saint Benoît sur Loire). Au quatorzième siècle, la cathédrale d’Orléans a été un des tous premiers édifices à posséder un orgue. Un des plus beaux orgues du département est celui de Lorris, dont le buffet renaissance date de 1501, et qui est le plus vieil ensemble (buffet plus matériel sonore) de France. Le Loiret dispose de 9 orgues classés monument historique, et un à l’inventaire supplémentaire (celui de Châtillon Coligny pour la partie instrumentale).
La révolution de 1789 a marqué un déclin de l’orgue utilisé comme instrument liturgique, mais aussi une évolution technologique majeure due aux progrès industriels et l’apparition d’autres utilisations, avec la création d’instruments plus petits (« orgues de salon ») installés chez de riches particuliers ou dans des théâtres.
Les facteurs d’orgues Orléanais au XIXème siècle
Un certain nombre de facteurs d’orgues sont nés ou ont exercé leur art à Orléans au XIXème siècle, dès la première moitié : Louis Petitet, (1811 – 1888), Jean Baptiste Laureau dit Claude Lorot (1813 – 1892), Augustin Tabard qui partit dans l’Allier après son mariage (1815 – 1868) ; mais aussi plus avant dans le siècle : Charles Beaurain (1826 – 1907), Alfred Lorot (neveu de Claude) (1843 – 1918), Georges Arthur Péan (1850 – après 1915), Charles Durant (1846 – après 1902)
Nombre d’entre eux vivaient au faubourg Saint Marceau autour de l’église du même nom, dont, en 1891 – 1892, Alfred Lorot restaura et augmenta les jeux d’un orgue qui a disparu depuis. Alfred Lorot et Charles Beaurain étaient par ailleurs amis puisque Charles Beaurain fut témoin au mariage d’Alfred Lorot en 1868.
A part Alfred Lorot dont l’oncle Jean Baptiste dit Claude était facteur d’orgues, aucun n’était issu de familles de musiciens ou de facteurs d’orgues : le père de Claude Lorot était chapelier, celui de Louis Petitet cabaretier, celui de Charles Beaurain vigneron …
Par contre, certains eurent des maîtres prestigieux : Claude Lorot fut l’élève de Louis Callinet, et Charles Beaurain celui d’Aristide Cavaillé Coll.
Les différentes parties d’un orgue
Quelle que soit la taille de l’instrument, l’orgue est composé très schématiquement des éléments suivants :



- La console, regroupant claviers et commandes. Les claviers peuvent être disposés de telle sorte que l’organiste tourne le dos au public ou à l’officiant, ou de telle sorte qu’il voit le prêtre et puisse ainsi mieux synchroniser son jeu avec l’officiant. Les registres de jeux permettent de solliciter un groupe de tuyaux rendant une sonorité particulière (ex : flûte, voix humaine, basson …). Si aucun registre n’est tiré, le clavier est muet
- la soufflerie, regroupant réservoirs et production de vent ; autrefois, la production de vent destiné aux tuyaux était manuelle : un levier à main ou à pied permettait d’actionner des soufflets. De nos jours, cette partie a été électrifiée.
- le sommier, permettant l’accès du vent aux tuyaux ;
- la tuyauterie, englobant le matériel sonore. Chaque tuyau émet un seul son de hauteur et de timbre déterminé. Si la hauteur du son émis dépend essentiellement de la longueur du tuyau, son timbre dépend de nombreux paramètres dont sa matière, sa forme et le mode de production du son. Le plus souvent on compte 56 tuyaux par jeu, soit 840 pour un orgue de 15 jeux. L’orgue de Notre Dame de Paris compte près de 8000 tuyaux. Les tuyaux visibles sur le devant de l’orgue sont appelés la montre.
Ces éléments peuvent être regroupés en totalité ou en partie dans un meuble appelé buffet.
Le buffet, dont les deux fonctions initiales sont de cacher et protéger, joue également un rôle essentiel de porte-voix et de résonateur ; il constitue souvent chez les anciens instruments une œuvre d’ébénisterie très travaillée témoignant du style de leur époque, alternant parties de menuiserie richement sculptée et espaces occupés par les tuyaux de montre disposés en plate-faces et tourelles en nombre varié.
L’orgue de Courtenay : un orgue remarquable

L’orgue de Courtenay, situé dans la tribune Ouest de l’église abbatiale du XVIème siècle Saint Pierre et Saint Paul de Courtenay possède dans sa console face au public 2 claviers (56 et 44 notes), un pédalier à l’allemande (20 notes) et quinze appels de registre. Son buffet en sapin peint est la pièce la plus ancienne puisqu’elle date de la construction initiale par Claude Lorot en 1859. Bien qu’il ait été électrifié en 1968, il possède une pompe à bras latérale encore fonctionnelle.
En 1859, Claude Lorot avait érigé un instrument de 6 jeux sur un clavier. Seul en reste le buffet en sapin, dont l’esthétique rappelle celle de l’école de Louis Callinet (le parisien) à laquelle appartenait Claude Lorot. Le neveu de Claude Lorot, Alfred, le reconstruisit en 1902 pour la somme de 6500F, en lui donnant sa configuration actuelle. Il fut inauguré le 23 février 1904 par Edouard Mignan, jeune organiste de Saint Paterne d’Orléans, qui obtint un Prix de Rome de composition en 1912 et succéda à Henri Dallier aux Grandes Orgues de l’église de la Madeleine à Paris en 1935. Depuis, l’orgue a subi peu de modifications : remise en état en 1968 -1969 par la maison Gutschenritter/Masset avec installation d’une soufflerie électrique et en 1981 par Christian Millot de Saulieu.
Au printemps 2004, l’église a nécessité d’importants travaux de rénovation (toiture poreuse …). Le plancher de la tribune devait être refait. L’orgue fut donc entièrement démonté et transporté en atelier pour un nettoyage et une restauration complète, sans lui faire perdre son authenticité.
Ainsi, cet orgue est le seul qui reste dans lequel on peut admirer le travail des deux Lorot, qui étaient considérés comme de très bons artisans. Par ailleurs, il a une excellente sonorité bien servie par l’acoustique de l’église dans laquelle il est installé et, de l’avis des organistes qui l’ont joué, il est très agréable d’usage.
Grâce à l’association de Amis de l’Orgue de Courtenay, outre sa fonction liturgique, il est utilisé régulièrement pour des concerts profanes.
Un dossier de classement au titre des monuments historiques est actuellement instruit.
Cet article a été publié dans le numéro 48 du bulletin de l’association Epona
Sources :
- François Henri Houbart, « Histoire de l’Orgue en Orléanais et dans le Loiret », éditions Delatour, 2016, et conférence sur le site des Archives Départementales d’Orléans le 14 décembre 2016, https://www.archives-loiret.fr/vie-culturelle-2/conferences/histoire-de-lorgue-en-orleanais-et-dans-le-loiret-le-14-decembre-a-18h
- Documents communiqués par l’association des Amis de l’orgue de Courtenay : http//amisorguecourtenay45.fr
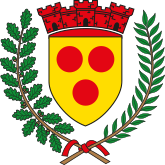

Laisser un commentaire