Les premières tentatives d’éclairage public remontent au XIVème siècle, principalement dans les grandes villes où l’obscurité de la nuit favorisait la criminalité. Ce furent d’abord des chandelles : au XIVème siècle, trois chandelles étaient maintenues allumées toute la nuit à Paris : devant la prison du Châtelet, à la Tour de Nesles et au cimetière des innocents. On tenta ensuite d’obtenir des propriétaires qu’ils maintiennent une chandelle allumée sur une des fenêtres du premier étage sur la rue, mais outre le risque d’incendie, la durée de combustion et donc d’éclairage était limitée, ce qui ne faisait que déplacer le problème, expliquant le peu de succès de cette préconisation. Au XVIIème siècle apparaissent des porte-lanternes qui, moyennant louage, éclairaient la nuit les passants. Pour facturer leurs services, ils portaient un sablier estampillé aux armes de la ville. En 1667, le lieutenant de police Nicolas de La Reynie fit établir 6 500 lanternes dans Paris. Les premières lanternes étaient garnies de chandelles et étaient positionnées à chaque extrémité des principales rues avec parfois une autre au milieu. La peine des galères était réservée à ceux qui auraient brisé ces lanternes. Elles existèrent jusqu’en 1763, où elles furent remplacées par 2 400 réverbères à huile qui présentaient l’avantage de pouvoir brûler toute la nuit. En 1829, la rue de la Paix reçoit le premier éclairage public au gaz. En 1830, Paris compte 9 000 becs de gaz et 3 000 lanternes à huile. Très rapidement, ces becs de gaz se répandent au point qu’on en compte plus de 20 000 en 1870.
Les réverbères à huile étaient allumés le soir et éteints le matin par des « allumeurs de lanternes » qui parcouraient les rues, l’échelle sur l’épaule, les nettoyaient et les entretenaient. En 1859, ils disparaissent au profit des allumeurs de réverbères qui s’occupaient de l’éclairage au gaz. Les heures d’allumage et d’extinction des réverbères à huile ou au gaz étaient fixées par le préfet.

Allumeur de réverbère, Stokholm 1953.Gunnar Lanz — Stockholms stadsmuseum,
Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5308102
En dehors des très grandes agglomérations, il semble qu’il n’y ait eu que très peu d’éclairage public avant le milieu du XIXème siècle. Ainsi, dans le gâtinais, la plupart des communes, les moins peuplées, n’ont probablement eu aucun éclairage public jusqu’à l’avènement de l’électricité. Les gens qui se déplaçaient la nuit portaient leur propre lanterne. On ne trouve d’ailleurs pas non plus de traces à Courtenay ou à Château Renard avant la fin du XIXème siècle. Peut-être y avait-il quelques lanternes à huile à des endroits stratégiques dans les villes.
L’apparition des usines à gaz va révolutionner l’éclairage public.
Les usines à gaz
Dans le canton de Montargis, deux localités disposaient d’une usine à gaz : Montargis et Courtenay. Après l’installation à Paris d’une usine à gaz en 1827, la diffusion de ces usines de fabrication du gaz d’éclairage va ensuite couvrir progressivement tout le territoire en commençant par les villes les plus importantes. Ainsi l’usine à gaz de Montargis devance de près de 40 ans celle de Courtenay.
Ces deux usines avaient pour seule vocation de produire du gaz pour l’éclairage public.
La fabrication du gaz d’éclairage
Le gaz dit de houille utilisé jusqu’au début du XXème siècle est obtenu par combustion de la houille qui donne jusqu’à 20% de son poids en produits gazeux et laisse pour résidu du coke qui peut être revendu, permettant ainsi de rentabiliser en partie les installations. La présence dans ce gaz de houille de produits toxiques (monoxyde de carbone, sulfure d’hydrogène …) nécessite une épuration.
Le gaz obtenu était stocké dans des gazomètres. Les premiers modèles, au XIXème siècle, sont dits « télescopiques » Le gaz est conservé sous une cloche qui se déploie et s’élève au fur et à mesure que le gaz la remplit. Cette cloche est posée sur un réservoir d’eau dont la fonction est d’assurer l’étanchéité à la base et d’empêcher ainsi le gaz de s’échapper.

gazomètre télescopique. Louis Figuier, Public domain, via Wikimedia Commons
Au début de l’exploitation du gaz de houille, les conditions de travail dans les usines sont épouvantables. Le procédé de fabrication étant discontinu, le déchargement du coke des cornues et le chargement de la houille a lieu à chaud. À sa sortie, le coke s’enflamme et doit être éteint avec des seaux d’eau. Tout y était, chaleur, poussières, vapeurs irritantes, toxiques et cancérigènes.
L’usine à gaz de Montargis

L’usine à Gaz de Montargis, située rue André Coquillet a été construite en 1845 et est restée active jusqu’en 1961. En mai 2003, une étude mandatée par le Ministère de l’environnement et Gaz de France pour retrouver les anciennes cuves de l’usine à gaz nous a fourni une description précise de ses installations : (https://www.loiret.gouv.fr) Autour de la cour se répartissaient les bureaux, la maison du directeur, la salle des fours, une salle d’épuration, un atelier de débenzolage, un magasin aux huiles, un atelier à sulfates, des vestiaires, une salle d’essai et un magasin à compteurs. Quatre cuves ont été identifiées, dont deux gazomètres.
L’usine à gaz de Courtenay
L’usine à gaz de Courtenay est plus récente que celle de Montargis puisqu’elle a été construite en 1883. Elle était située rue des Ponts, au bord de la Cléry. Son activité a perduré jusqu’aux années 1970.

Monsieur André Neveu, ancien maire de Courtenay, né en 1923, se souvient : « tous les jours, une charrette à cheval apportait la houille arrivée par le train jusqu’à l’usine à gaz ». « Le gaz était stocké dans un gazomètre posé dans un bassin rempli d’eau ». Monsieur Bruno Tripot, ancien maire de Saint Hilaire les Andrésis qui gérait une entreprise de BTP complète : « Je récupérais le mâchefer pour mon entreprise ».
La situation au bord de la rivière de cette usine à gaz explique sans doute qu’elle ait été inondée lors de la grande crue de 1910, entraînant une interruption de plusieurs jours de l’éclairage urbain. (https://inforisques.loiret.fr/memoire-du-risque/janvier-1910-crue-historique-du-loing-montargis-et-ses-alentours).
Les autres communes de notre région n’ont pas eu d’usine à gaz, possiblement car l’installation tardive de celles-ci aurait coïncidé avec l’apparition de l’éclairage électrique beaucoup plus simple. Ainsi l’examen attentif des cartes postales de Château Renard au tout début du XXème siècle, s’il ne permet pas de retrouver de réverbères, nous montre par exemple sur la place de la République (café de la Place) une applique électrique.

Les réverbères
Les premières lanternes d’éclairage public étaient fixées aux murs ou suspendues. Vers 1830 apparaissent les premiers réverbères sur pied, à la fois pour l’huile et le gaz. Leur avantage pour l’éclairage au gaz étaient bien sûr qu’ils pouvaient contenir la conduite d’alimentation du gaz.
Au début, les fabricants de réverbères étaient plus ou moins libres pour la fabrication de leur mobilier. Mais à la suite à de nombreux accidents dus à la mauvaise qualité de certains candélabres, ils furent amenés à fournir uniquement des candélabres en fonte, plus solides et plus résistants, comme en atteste ce passage : « L’éclairage des rues incite à veiller tard, à sortir et à fréquenter les débits de boissons. Conséquences : les couche-tard rentrent chez eux en titubant, s’accrochant aux réverbères, lesquels plient sous leur poids : les conduites de gaz se fissurent ou cassent et c’est l’accident. Les fabricants de réverbères sont donc amenés à en construire en fonte, solides et résistants dans les années 1880 » (charcot.etab.ac-lyon.fr/histoire_eclairage).
C’est donc bien un réverbère en fonte que l’on voit sur cette carte postale de Courtenay.

L’éclairage public a connu son apogée au XXème siècle, mais aujourd’hui, à l’heure de la lutte contre la pollution nocturne et le gaspillage énergétique, nos rues retrouvent peu à peu leur obscurité nocturne et les lampadaires s’éteignent …
Cet article a été publié dans le numéro 49 du bulletin de l’asociation Epona
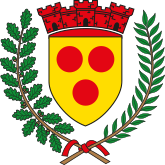

Laisser un commentaire